(Les images sont en plus grand plus bas sur cette page)
Si la campagne atteint les 200%, j’offre 3 cartes avec chaque exemplaire papier de Bayou. Mais lesquelles?
Votez!
















Urban Fantasy
(Les images sont en plus grand plus bas sur cette page)
Si la campagne atteint les 200%, j’offre 3 cartes avec chaque exemplaire papier de Bayou. Mais lesquelles?
Votez!
















Toute histoire a son origine. Cet article raconte l’origine d’une histoire d’origine. C’est moins complexe qu’il n’y paraît. Ou peut-être plus.
À vous de juger.
Le 3 juillet 2019, je suis tombée par hasard sur une couverture de livre « prête à publier » (comme du prêt-à-porter, mais pour les livres). J’étais sur le point de commencer le premier roman d’une nouvelle série, roman pour lequel j’avais déjà une couverture. Mais le design que j’avais sous les yeux était énergique, unique, et m’a immédiatement conquise. Seul problème: le personnage représenté était un homme. Jusque là je n’avais écrit que des personnages féminins, et je ne me sentais pas prête à me glisser dans la peau d’un mec. Sauf que je suis faible face aux belles couvertures (mes complices des Plumes de l’Imaginaire et notamment Charlotte Munich peuvent le confirmer). J’ai acheté la couverture, et j’ai commencé à créer le personnage qui allait avec. C’est ainsi qu’est né Germain Dupré, premier personnage de ma nouvelle série, Paris des Limbes.

Six mois plus tard, je publiais le Codex de Paris, non sans sueurs froides: mon personnage masculin serait-il crédible? Et mes lectrices me suivraient-elles dans cette nouvelle série?
3 ans et une adaptation audio plus tard, je crois que la réponse est « oui ». Mais je n’en avais pas pour autant terminé avec ce roman. Un personnage secondaire réclamait qu’on raconte son histoire et ses origines. Je m’étais promis de le faire « un jour ». Quand les projets plus urgents m’en laisseraient le temps. Mais les projets n’en finissaient pas de s’enchaîner, et je ne prenais pas le temps. Jusqu’à ce que mon esprit se range du côté de ce personnage secondaire et refuse d’écrire quoi que ce soit d’autre.
J’ai essayé de forcer, décidée à écrire la suite d’Un Casse en Enfer comme promis aux lectrices. En vain, je n’arrivais à rien. J’ai dû céder.
3 mois pour écrire ce petit roman « vite-fait », histoire de me le sortir de l’esprit, et je me remettrais sur des projets plus importants.
Le « petit » roman s’est doté d’intrigues et de points de vue supplémentaires pour devenir mon texte le plus long à ce jour.
J’ai décidé qu’en plus de l’aspect fantastique et de l’enquête policière, j’allais intégrer une romance — ma première.
Non seulement l’histoire allait se dérouler en 1900, mais les deux protagonistes viendraient de cultures différentes (rrom pour elle, japonaise pour lui). Tout cela allait demander un peu de recherche.
Quelques milliers de pages de documentation plus tard, les 3 mois se sont changés en 6, en 9, puis en 11.
Et je ne peux pas dire que j’ai procrastiné, ou que je me suis montrée fainéante. Pendant ces 11 mois, j’ai travaillé à temps plein sur ce roman. Je n’ai pas fait plus de recherches que nécessaire. J’ai même pu gagner du temps sur le volet japonais de l’affaire, puisque la langue et le folklore japonais sont le sujet d’une grande partie de mes études supérieures.
Mais je me suis posé tellement de questions…
J’ai vécu assez longtemps dans Paris, mais la ville a changé depuis l’année 1900. J’ai consulté des plans anciens. Et comment rendre compte de la folie de l’Exposition universelle? Toute une série de romans ne suffirait pas. Pourtant, j’ai amassé assez de vieux guides et d’articles de magazines d’époque pour l’écrire, cette série.
Mais les plus beaux souvenirs de recherches, ce sont les romans de Matéo Maximoff. Cet auteur Rrom n’est malheureusement plus publié, et j’ai dû écumer les sites d’occasion pour me procurer quelques-uns de ses titres. Quelle belle rencontre! Il m’a fait découvrir une culture et un univers merveilleux, et je ne saurai trop recommander ses textes.
Une fois renseignée, il a fallu écrire.
Pour être exacte, ces deux processus (la recherche et l’écriture), je les ai menés en parallèle. L’intrigue dicte ce que je dois trouver comme information, mais ce que je découvre au fil de mes lectures ouvre de nouvelles perspectives dans lesquelles emmener mon histoire. J’ai planifié un roman. J’ai lu. J’ai amendé mon plan. J’ai encore lu. Ajouté une intrigue secondaire. Lu encore. Créé des listes d’événements, des tableaux chronologiques, et collé plus de fiches sur les fenêtres que je n’ose l’avouer. Ajouté un troisième arc narratif. Un nouveau point de vue. Fait de nouvelles recherches… pendant presque un an.
Je me suis lancé des défis. Pour la romance, bien sûr. Mais aussi pour le personnage masculin et le — les — méchants de l’histoire. J’ai tenté quelques techniques d’écriture dans lesquelles il est facile de se prendre les pieds.
Au 10e mois, mon texte « pesait » presque 100 000 mots.
Alors j’ai commencé à le retravailler. Trouver les incohérences et y remédier, développer les points que j’avais à peine esquissés, couper les passages inutiles ou redondants…
Le roman s’est un peu allégé. Je l’ai encore une fois corrigé. Relu une dernière fois. Et je me suis mise à la recherche de mes premières lectrices.
Depuis que j’ai commencé à publier, j’ai la chance d’avoir d’extraordinaires bêta-lectrices à mes côtés. Et cette fois comme les autres, elles ont répondu à mon appel. En 15 jours elles ont lu le mastodonte et fait remonter des commentaires de fond comme de forme.
Pendant qu’elles effectuaient ce travail de fourmi, je préparais une parution hors-norme. En plus des défis liés à l’écriture, j’avais décidé de proposer une édition grand format avec une couverture cartonnée, un verni sélectif, des illustrations pour les têtes de chapitre et au fil du texte. Bref, le grand jeu.

Dans une de mes précédentes carrières, je suis tombée amoureuse de beau travail d’imprimerie. En tant qu’autrice indépendante tributaire de l’impression à la demande, je suis toujours un peu frustrée. (Entendons-nous bien. L’impression à la demande représente une révolution, et sans elle je n’en serais pas là où je suis aujourd’hui. Mais parfois c’est bien de pouvoir fignoler une édition.)
Avec Le Palais des Illusions, j’ai voulu me — et vous — faire plaisir.
Mais bien sûr, cette version ne peut pas être proposée sur Amazon (encore une fois, pour la vente en ligne je reste tributaire de l’impression à la demande). J’ai donc organisé une campagne de précommande sur Ulule, tout en prévenant les lectrices et lecteurs: l’édition collector paraîtrait en avant-première, et une édition « normale » (au format poche de tous mes autres romans sur Amazon) suivrait deux mois plus tard.
« Deux mois plus tard », c’est le 15 mai.
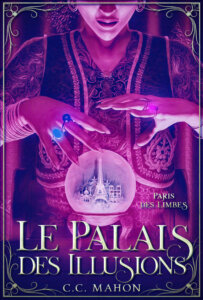
Voilà, nous y sommes presque. Après plus d’un an de travail, de découvertes et de questionnement.
Dans Le Palais des Illusions, j’ai pris des risques. Celui d’écrire du point de vue d’une culture stigmatisée et marginalisée, une culture qui n’est pas la mienne. Ai-je rendu justice à Cali la jeune Rrom? Ai-je su rendre compte du choc inévitable quand les mondes nomades et sédentaires se rencontrent? Ai-je su éviter la généralisation abusive ou suis-je tombée tête la première dans les clichés?
L’avenir me le dira.
L’ebook du Palais des Illusions est en précommande. Il rejoindra les liseuses le 15 mai. D’ici là, je vais continuer à me poser ces questions.
By C. C. Mahon
Minuit.
Le Monoprix était le seul îlot de vie dans ce quartier parisien endormi.
Au-dessus du supermarché s’empilaient sept étages d’un immeuble de béton, laid et aussi avenant qu’un mur de prison. Une lumière jaune pisse filtrait entre les volets rouillés du premier étage.
Devant la porte en verre de l’immeuble, un adolescent boutonneux fumait une cigarette, l’air blasé dans son survêtement de marque. Zagan plissa le nez en traversant le nuage de fumée. Le gosse toisa Zagan, détaillant son costume de luxe et son écharpe en cachemire avant de tendre la main pour lui barrer le passage.
— T’es qui, et qu’est-ce que tu viens foutre ici ?
Visiblement, la haute couture italienne n’impressionnait plus.
— Zagan, président des Enfers. C’est pour un casse.
Le gosse fronça ses sourcils broussailleux et son menton fit un bond en avant.
— Kesstud… ?
Il jeta sa cigarette au sol et porta la main à sa poche.
Zagan l’attrapa à la gorge et le claqua contre le mur. Bruit clair d’une caboche vide contre un parement de pierre, et la sentinelle s’effondra comme un paquet de linge sale. Zagan rajusta le col de son manteau de laine vierge, enjamba l’obstacle, et pénétra dans l’immeuble.
L’ascenseur puait la clope, et Zagan regretta d’avoir eu la flemme de monter un étage à pied.
Dans le couloir, la moquette marron foncé était si élimée qu’elle n’étouffait plus grand-chose. Les richelieus de Zagan éveillèrent un écho mat, et une silhouette se redressa à l’extrémité du couloir.
Le type était à peine plus vieux que son collègue. De l’adolescence, il avait conservé une silhouette dégingandée et un visage marqué par l’acné. Il montait visiblement la garde, debout à côté d’une porte semblable à toutes celles de l’étage — métallique, bordeaux et percée d’un judas.
Comment ce gosse poussé en graine espérait-il empêcher quiconque d’entrer ? Zagan ne prit pas le temps de lui poser la question. Il claqua des doigts, et l’ado s’effondra à son tour.
Une pichenette ouvrit le vantail à la volée. Une exclamation sourde fusa, suivie d’un bruit de chute. Le guignol qui se tenait derrière la porte se l’était prise en plein nez.
Zagan enjamba le corps inerte et pénétra dans l’antre des trafiquants de drogue.
L’antre en question était un appartement vieillot et mal entretenu. L’air empestait le tabac froid et le fond de poubelle. Au sol, le Lino semblait jaune, à moins qu’il ne soit simplement sale. Plusieurs couches de crasse ornaient les murs. Sur la gauche, Zagan aperçut la salle de bain, qu’un malade avait un jour décidé de couvrir de moquette lie-de-vin du sol au plafond. Zagan pouvait comprendre qu’un tel décor pousse son occupant à la drogue. Même en enfer on n’aurait pas osé tant de laideur.
Un claquement retentit au fond de l’appartement : quelqu’un venait de renverser une chaise. Une fenêtre crissa. En trois enjambées Zagan rejoignit sa proie.
— Kevin Bernard ?
L’interpellé se figea, à cheval sur l’appui de fenêtre, et tourna un visage de fouine vers Zagan. Derrière sa frange blonde, ses yeux papillonnèrent un instant.
— Oui ? couina-t-il.
Il portait une tenue de sport, mais sa poitrine creuse et ses cannes maigres n’avaient probablement jamais pratiqué d’activité physique.
Zagan l’attrapa par le col et le ramena à l’intérieur. L’odeur de la peur vint se mêler aux parfums fétides de l’appartement.
— Il ne faut pas jouer au-dessus du vide, tu risquerais de te faire très mal.
Il reposa Kevin au milieu de l’appartement, entre le canapé défoncé et la table de cuisine sur laquelle s’empilaient des douzaines de briques de poudre pâle et mortelle.
— Alors comme ça c’est toi, le nouveau Cador de Paname ? fit Zagan.
— Le… quoi ?
— Le minable qui a décidé de se passer de ma protection, a rallié une bande de dealers à la petite semaine, a incendié mon night-club, et estropié mes hommes.
Un éclair de compréhension passa dans le regard de Kevin.
— Ah. Ça. Vous êtes monsieur Mathieu ?
— Il paraît, marmonna Zagan.
À dire vrai, Mathieu avait vidé les prémisses un an plus tôt, et Zagan se servait de son corps et de son identité.
— Ça fait un an, protesta le dealer. Vous n’êtes pas passé à autre chose ?
— Dix mois, corrigea Zagan. La vengeance est un plat qui n’a pas de date de péremption, comme vous aimez à le rappeler.
— Moi ? J’ai jamais…
— Les humains. C’est bien ce que vous dites, non ? « La vengeance est un plat qui…
— « Qui se mange froid, » compléta Kévin.
— Vraiment ? J’étais persuadé… Bref. Évidemment que je suis passé à autre chose. À vrai dire tu es le dernier de la liste. Maintenant je préfère tenir les gens responsables de leurs actions. C’est très satisfaisant, et bien plus rémunérateur. Et puis la drogue, c’est pas vraiment en accord avec le libre arbitre. Et je suis très « libre-arbitre ».
Le dealer lui renvoya un regard vide.
Comment ce type avait-il pu se hisser au sommet du trafic de drogue de l’Ouest parisien ?
J’ai éliminé tous les trafiquants compétents, et la lie est remontée à la surface. À propos de lie… Je m’ouvrirais bien une bonne bouteille en rentrant. Un rouge bien charpenté pour aller avec mon chocolat au piment.
— Euh… Monsieur Mathieu ? appela l’humain d’une voix tremblante.
À la mention de son identité officielle, Zagan sortit de sa rêverie.
— Oui ? Où en étions-nous ?
— Vous… alliez partir ?
— C’est ça !
Le soulagement déferla sur le visage pointu du dealer.
— Donc… Sans rancune ? fit-il. Puisque vous avez arrêté le trafic de drogue de toute façon…
Zagan soupira. Dans la poitrine de Kevin il pouvait sentir le cœur battre à toute vitesse, les artères déformées par la pression du sang.
Ces humains sont si fragiles. Une simple panne dans la pompe centrale, et tout est fini.
Il désigna la table de cuisine et les paquets de poudre entassés dessus.
— Tu sais ce que c’est ?
— Mon stock d’héroïne ?
— Plus maintenant.
— Vous… Bien sûr. Allez-y, prenez ce que vous voulez !
Zagan fit remonter son sourcil gauche vers la naissance de ses cheveux bruns.
— Moi ? Que veux-tu que je fasse avec trente kilos de lait pour bébé prématuré ?
Le dealer écarquilla les yeux, puis secoua la tête.
— J’vous jure, c’est de la première qualité !
— Plus maintenant. À partir de cet instant toute la drogue qui te passera entre les mains se transformera immédiatement en lait pour prématuré. C’est valable pour tes subordonnés, associés, et toute personne qui pourrait manipuler de la drogue pour toi. Tu connais Midas ?
— Les pots d’échappement ?
Zagan se massa les paupières. Ces humains l’épuisaient.
Il se tourna vers la table de cuisine et repéra la boîte à chaussures coincée entre deux tas de lait en poudre. Un signe de l’index, et les liasses de billets qu’elle contenait traversèrent la pièce jusque dans sa main.
— Merci pour ce don. J’ai aussi siphonné tes comptes à la Banque Postale. J’en ferai bon usage.
Kevin poussa un hurlement de bête blessée.
— Mon fric !
Mais déjà Zagan se dématérialisait.
By C. C. Mahon
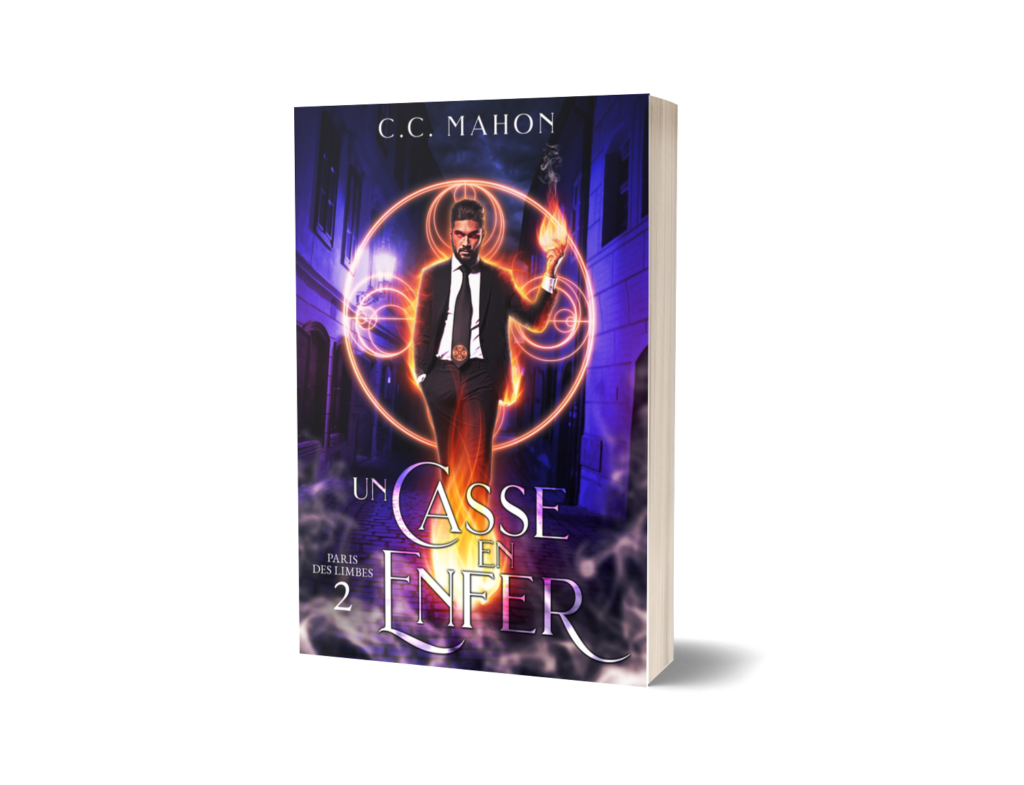
By C. C. Mahon
Alexander Grall parlait au nom d’un clan adepte du silence. Ce clan c’était Grall, un empire du luxe de dimension internationale. C’était aussi sa famille. À vingt-cinq ans, il était devenu pourvoyeur de belles histoires à destination de la presse et du public, gardien de secrets dont lui-même ignorait tout. Comme la raison pour laquelle sa grand-mère était entrée dans une colère noire la veille.
« Vous arrivez à destination », annonça la voix métallique du GPS.
Alexander freina, et sa décapotable s’immobilisa. C’était un petit bolide fabriqué dans les années cinquante, restauré avec amour et acheté à prix d’or. Penché sur le volant en cuir, Alexander examina la rue étroite.
Où est ce fichu musée ?
Sous le soleil d’août, le Nord était loin de l’image qu’Alexander s’en était faite. À sa gauche, le ciel d’un bleu parfait contrastait avec la brique des modestes maisons ouvrières. À droite, un panneau indiquant « Musée des Beaux-Arts » pointait vers un portail moderne ouvrant sur un grand parc. Mais il s’agissait d’une allée piétonne, à l’accès barré par des poteaux en acier. Des touristes matinaux se dirigeaient vers le musée. Alexander repéra aussi des photographes de presse, dont la présence lui rappela la raison de sa venue à Lens, et la colère subie la veille.
Quelle mouche avait donc piqué Colette ?
Colette Grall dirigeait Grall International d’une main de fer depuis bien avant la naissance d’Alexander. Celui-ci avait toujours connu sa grand-mère aux manettes de l’entreprise et de la famille. Même quand son mari Denis était encore en vie, Colette seule prenait toutes les décisions. Peut-être était-ce pour ça qu’elle était si fâchée la veille. Parce que, pour une fois, Denis avait décidé sans elle.
Derrière la décapotable, un car de tourisme klaxonna. Quelques mètres plus loin dans la rue, un panneau routier indiquait le dépose-minute du musée. Alexander embraya et prit cette direction en grommelant.
Où est donc l’entrée de ce satané musée, et pourquoi grand-père n’a-t-il pas fait ce legs à Orsay ?
Denis Simon-Grall avait été un grand-père distant et intimidant. Il sortait rarement de son bureau et s’intéressait peu au plus jeune de ses petits-enfants. Alexander ne l’en avait que plus aimé. Quand Denis était mort, Colette s’était retirée dans son deuil, laissant ses enfants et petits-enfants se charger des questions d’héritage. Le testament n’avait surpris personne : il léguait toutes ses possessions à son épouse Colette, à l’exception de quelques objets personnels répartis entre ses trois enfants, et d’un ensemble hétéroclite d’œuvres d’art, qu’il voulait offrir au nouveau musée de Lens.
Parce qu’il était chargé des opérations de relation presse et de mécénat, Alexander avait tout naturellement endossé la responsabilité d’organiser ce don. Il y avait travaillé pendant les mois suivants, dans l’indifférence générale. Jusqu’à la veille, quand il avait évoqué son départ vers Lens.
Ce soir-là, Alexander et Colette dînaient seuls à la longue table du manoir, au milieu de la forêt de Fontainebleau. L’endroit était si calme qu’on entendait le tic, tac de l’horloge depuis le grand couloir. Au milieu de la nappe blanche, les flammes des chandelles jouaient sur les verres en cristal. Les murs de lambris ivoire aux moulures dorées se drapaient des ombres du soir, et les tapisseries médiévales tendues aux murs semblaient s’animer dans la lumière dansante. Colette présidait depuis la place d’honneur, le port altier, ses cheveux formant une couronne de neige autour de son visage fin. Assis à la droite de sa grand-mère, Alexander mangeait en silence. Colette parlait peu, et n’appréciait guère le bavardage.
Un concert de klaxons arracha Alexander à ses réflexions. Quelque chose bloquait l’accès au dépose-minute du musée, où Alexander avait prévu de se garer. Son Aston Martin prise en sandwich entre deux énormes cars de tourisme, il jeta un coup d’œil à sa montre – une Piaget aux lignes épurées – et lâcha un juron. Il lui restait moins d’une heure avant l’inauguration. Avec quelques centimètres de marge à peine, il manœuvra l’Aston pour s’extraire de la file de cars et accéléra dans un rugissement de moteur, à la recherche d’un autre accès au musée. La rue était étroite et bordée d’arbres, les trottoirs larges mais protégés par des barrières en bois. Pas une place de parking en vue.
Il savait que ce déplacement serait frustrant. Au cours du dîner de la veille, déjà, il avait ronchonné à propos de son départ pour le Nord, où il avait prévu de passer la nuit dans le seul hôtel quatre étoiles proche de Lens.
À l’extrémité de la table, Colette avait froncé les sourcils.
— Que vas-tu faire dans les corons ?
— Le musée organise un vernissage pour l’exposition dédiée à grand-père.
Colette avait reposé son couteau à poisson, lentement, et dévisagé Alexander.
Il avait ressenti le besoin de s’expliquer.
— Ils ont installé le legs dans une salle particulière, qui portera le nom de grand-père. L’exposition permanente sera inaugurée demain. Nous avons convié la presse et la télévision. Isobel a mis le dossier de presse en page, regardez…
Il avait affiché le document sur l’écran de son smartphone. Colette aimait suivre les réalisations d’Isobel, la première de ses arrière-petits-enfants à intégrer l’entreprise familiale…
Devant la décapotable, une touriste en robe fleurie traversa la chaussée, et Alexander pila. Alors qu’il suivait l’imprudente du regard, marmonnant des injures, il repéra une place libre dans une petite rue adjacente. Il y gara l’Aston Martin avec toute la délicatesse d’un Parisien frustré par la province.
Pourquoi ai-je accepté de venir me perdre ici ? Plus jamais je ne remettrai les pieds aussi loin du Périph.
Il s’extirpa de sa voiture et ouvrit le coffre pour en sortir une pile de dossiers de presse. Son regard s’arrêta sur le modeste dessin reproduit au dos de la plaquette : l’esquisse d’une ballerine attribuée à Degas. Quand Colette avait découvert ce dessin, sur le smartphone d’Alexander, le sang s’était retiré de son visage. Un instant, Alexander avait craint qu’elle ne fasse un malaise. Sa grand-mère avait une santé de fer, mais elle n’avait plus vingt ans… Pourtant, ce n’était pas une crise cardiaque qui l’avait saisie à la vue du dessin, mais une colère comme elle en démontrait rarement.
— Qu’est-ce que ça fait là ? avait-elle soufflé en désignant la ballerine.
— C’est… Ça fait partie du legs. Le Degas était avec quelques autres, dans le bureau de grand-père.
— Non.
— Il n’était pas dans un cadre, c’est vrai, mais dans un carton à dessins. Apparemment son père avait acheté un lot d’esquisses dans les années vingt, et…
Mais Colette n’écoutait plus. Elle s’était levée de toute sa (petite) hauteur.
— Personne ne doit voir cette ballerine. Jamais.
Sa main aux doigts déformés par l’âge s’était refermée sur sa serviette comme la serre d’un rapace.
Alexander avait protesté, balbutiant.
— Le Degas est au musée depuis des mois. Vous avez approuvé la liste des œuvres. Ce n’est qu’une fois entre les mains des experts que l’esquisse a été authentifiée, et il était trop tard pour…
Sur la serviette, les articulations de Colette étaient blanches.
— Personne ne doit savoir. Fais ce qu’il faudra.
Et, sur cette étrange injonction, Colette s’était retirée, abandonnant Alexander, choqué et dérouté, au milieu des dorures. Il avait quitté le manoir sans la revoir, et pris la direction du Nord, une boule au ventre. Il avait visiblement commis un terrible impair, et il ignorait comment il pouvait se rattraper. « Fais ce qu’il faudra, » avait ordonné Colette. Mais quoi ?
Alexander referma le coffre de l’Aston Martin avec un soupir. Une chose était certaine : il ne pouvait plus reprendre le Degas. Dans moins d’une heure il inaugurerait l’exposition Grall, et le public y découvrirait la petite ballerine que Colette aurait tant voulu cacher.
À cette idée, Alexander sentit l’angoisse remonter depuis ses tripes vers son estomac, et jusqu’à sa gorge, menaçant de l’étouffer. À tâtons, sa main droite trouva l’élastique qu’il conservait autour du poignet gauche, et le fit claquer. La douleur le ramena à la réalité, et il souffla. Ce n’était pas le moment d’avoir une crise de panique. Ce matin-là, l’image de la famille Grall dépendait de lui.
Alexander leva les yeux. Devant lui, le Musée des Beaux-Arts de Lens dressait sa silhouette massive au milieu des arbres, immense pavé de verre et d’acier. Un musée tourné vers l’avenir, un centre d’académisme en pays minier, une contradiction enveloppée dans un paradoxe. Un concept douloureusement familier.
Dans le hall du musée l’air était filtré, climatisé. Espace moderne au sol de pierre et aux parois de verre, le musée possédait les dimensions et l’élégance d’un hangar géant. Loin au-dessus des visiteurs, à huit ou neuf mètres du sol, les volets blancs du plafond tamisaient la lumière naturelle. Le moindre pas éveillait des échos caverneux.
Un troupeau de gosses en chasubles orange fluorescent traversa le hall, leurs piaillements résonnant dans le vaste espace. Alexander commença à se frayer un chemin entre les œuvres exposées – des pièces monumentales pillées aux quatre coins du monde antique – et les touristes matinaux. Au détour d’une fresque iranienne, un grand type vint à sa rencontre, main tendue. Il portait un costume bleu ardoise bien coupé – probablement du prêt-à-porter retouché – de grosses lunettes à monture épaisse et des tresses qui lui tombaient jusqu’aux épaules. Le bleu de sa chemise soulignait le noir de sa peau.
— Monsieur Grall ? Je suis Eddy Moreux. Nous nous sommes parlé au téléphone.
Alexander serra la main tendue. Moreux était l’attaché de presse du musée, et ils avaient organisé l’événement du jour ensemble.
— Tout est prêt ? demanda Alexander.
— Les œuvres sont installées, et la presse est déjà là. Vous voulez qu’on repasse le programme en revue ?
Alexander suivit l’attaché de presse dans le labyrinthe du musée. Ils laissèrent derrière eux les antiquités orientales, traversèrent une exposition de photographies monumentales consacrées aux bouddhas d’Afghanistan, contournèrent un assortiment de meubles médiévaux, et parvinrent devant une corde dorée qui interdisait l’accès d’une salle, aussi blanche et démesurée que les autres. Deux gardiens en costumes noirs barraient le passage. Alexander les salua d’un signe de tête.
Un panneau sur pied annonçait l’inauguration de la salle Denis Simon-Grall pour le jour même. Une flèche pointait vers la droite.
— Nous avons installé des micros et des chaises à côté pour la conférence de presse. Vous pourrez poser avec monsieur Buson pour quelques clichés…
Alexander fit la moue. Il avait rencontré le jeune conservateur une fois. C’était un grand type blond et trop maigre, collection de tics nerveux à lui seul. Probablement pas un pro des séances photo.
L’attaché de presse dut lire l’expression d’Alexander, car il argumenta.
— Un représentant de la famille du donateur remettant symboliquement un tableau au conservateur du musée, c’est une image plus parlante qu’une série d’œuvres accrochées sur un mur blanc. Si nous voulons une couverture maximale de l’événement…
Alexander acquiesça. Son grand-père avait légué ces œuvres de manière personnelle, mais leur remise au musée était l’occasion de faire mousser la marque Grall en rappelant les liens entre l’empire du luxe et le monde de l’art. Et si Alexander était venu se perdre si loin de Paris, ce n’était pas pour faire les choses à moitié.
— Quel tableau dois-je remettre à monsieur Buson ?
Moreux l’entraîna au-delà de la corde dorée, au travers d’une forêt de chaises pliantes jusqu’à un groupe de micros sur pieds et un chevalet couvert d’un drap blanc. La hauteur sous plafond semblait écraser le dispositif, rendant cet ensemble de chaises aussi insignifiant qu’une dînette au milieu d’une cathédrale. Moreux replia le drap, révélant un dessin de taille modeste encadré d’une simple baguette métallique.
— Je pensais à cette ballerine de Degas.
Alexander étouffa un grognement. Évidemment, Moreux avait choisi la seule œuvre qu’il ne fallait pas mettre en avant. Si Colette voyait Alexander et la ballerine en première page des journaux, elle allait…
Il préférait ne pas y penser.
— Trop petit, dit-il. Prenons l’un des Corot, celui avec le plus gros cadre. Ça rendra mieux.
Il consulta sa montre.
— Il nous reste vingt minutes. Vous voulez un coup de main ?
Trente secondes après avoir soulevé son coin du Corot, Alexander commença à regretter son choix. Dans son énorme cadre sculpté et doré, le tableau pesait une tonne. À l’autre extrémité du fardeau, Buson offrait un rictus crispé au crépitement des flashes. La sueur perlait sur le front du conservateur, causée par le stress, le poids du tableau, ou les deux. Malgré la brûlure de ses bras et les protestations de son dos, Alexander sourit de toutes ses dents, qu’il savait blanches et sans reproche. Il prit une grande inspiration et déclama son texte.
— C’est un grand honneur pour moi de remettre ces œuvres au musée, au nom de mon grand-père Denis Grall, de son épouse Colette et de toute la famille Grall…
Les flashes crépitèrent. Buson lâcha un petit gémissement et Moreux se précipita pour les soulager du poids du Corot. Avec l’aide de l’attaché de presse, Alexander et le conservateur replacèrent le tableau sur son chevalet, où les photographes l’immortalisèrent à nouveau. Buson prit la parole d’une voix chevrotante, et les journalistes posèrent quelques questions convenues.
Une vingtaine de minutes plus tard, ils étaient tous passés dans la seconde salle. Alors que les photographes tournaient leur attention vers l’exposition tout juste dévoilée, Alexander sentait encore ses reins protester. Il s’étira le plus discrètement qu’il le put.
— Vous auriez dû vous contenter du Degas, fit une voix revêche derrière lui.
Il se retourna et reconnut la vieille dame. Josette Gentille la mal-nommée avait expertisé les œuvres offertes au musée. C’était une petite femme voûtée, les cheveux teints au henné hérissés sur un crâne asséché par l’âge. Son odeur de cendrier et ses doigts jaunis trahissaient une dépendance au tabac, et son attitude générale une misanthropie caractérisée. Elle se planta trop près d’Alexander et pointa un doigt crochu sur sa cravate.
— C’est le Degas, l’œuvre maîtresse de ce fond. Mais il n’était pas assez imposant pour vous, hein ? Toujours à vouloir mettre de la poudre aux yeux, avec vos costards de luxe et vos chaussures italiennes.
Elle se tourna vers les photographes de presse, agglutinés devant les paysages de Corot.
— Et regardez cette bande d’imbéciles ! On accrocherait des posters aux murs qu’ils ne verraient pas la différence.
— Madame Gentille, que nous vaut le plaisir de votre présence ?
— Mademoiselle ! C’est moi qui ai authentifié tout le lot. Si quelqu’un a le droit de s’empiffrer de petits fours, c’est bien moi. C’est pas avec ce qu’on me paie ici que je peux m’offrir du caviar !
— Alors laissez-moi vous proposer une flûte de Champagne…
Il la prit par le bras pour l’éloigner de la presse, et elle se dégagea d’un geste brusque.
— Quoi, vous avez quelque chose à me demander ? Je suis assez grande pour me servir toute seule.
Elle partit vers le buffet en marmonnant dans son dentier.
Alexander se désintéressa de la vieille fille et pivota vers le centre de la salle. Buson discutait avec animation au milieu d’un groupe de journalistes. Pris par son sujet, le conservateur oubliait de cligner des yeux ou de se tordre les mains comme il le faisait d’habitude. Quelques pas plus loin, Moreux faisait de grands gestes devant la ballerine de Degas, comme un enseignant devant sa classe. Chaque fois qu’il bougeait, les perles d’argent qui décoraient ses tresses accrochaient la lumière des spots. Une poignée de reporters écoutaient ses explications, carnets de notes et enregistreurs en main. Une équipe de TV filmait des images d’illustration. Alexander laissa échapper un petit soupir de soulagement. C’était une belle inauguration, qui allait entretenir l’image de Grall International, et c’était tout ce qui comptait.
Sous les flashes de la presse, la petite ballerine de Degas rattachait son chausson. La voix de Colette résonna aux oreilles d’Alexander.
« Personne ne doit voir cette ballerine, jamais. »
Pourquoi Colette voulait-elle cacher ce modeste croquis ? Alexander n’en avait pas la moindre idée.
Il espérait simplement que ce dessin ne reviendrait pas le hanter.